|
demi-néologisme n.m. LING. - ø t. lex. réf. ; absent TLF.
1923 - «Coprochésie. - Etymologiquement, ce terme signifie répandre des ordures,
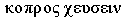 . Il évoque donc l'idée de la perte des excréments, en dehors des conditions psycho-physiologiques normales, puisque, dans le langage courant, on dit d'un vase qui a perdu son étanchéité qu'il répand. On peut donc l'employer génériquement pour désigner toutes les insuffisances vraies ou fausses des sphincters. Remarquons qu'en agissant ainsi, on ne crée qu'un demi-néologisme, puisque le terme de chésie est devenu synonyme de défécation, depuis que Robert Barnes et M.-A.-F. Hurst appellent dyschésie la difficulté d'évacuation rectale.» P. Courbon, in Annales médico-psychol., II, 115-6 - M.C. . Il évoque donc l'idée de la perte des excréments, en dehors des conditions psycho-physiologiques normales, puisque, dans le langage courant, on dit d'un vase qui a perdu son étanchéité qu'il répand. On peut donc l'employer génériquement pour désigner toutes les insuffisances vraies ou fausses des sphincters. Remarquons qu'en agissant ainsi, on ne crée qu'un demi-néologisme, puisque le terme de chésie est devenu synonyme de défécation, depuis que Robert Barnes et M.-A.-F. Hurst appellent dyschésie la difficulté d'évacuation rectale.» P. Courbon, in Annales médico-psychol., II, 115-6 - M.C.
médico-néologisme n.m. LING. - ø t. lex. réf. ; absent TLF.
1911 - «A cette dernière [la manie de la piqûre], élevée à la dignité d'entité clinique, comme représentant l'élément psychopathique de la morphinomanie, j'ai proposé de donner le nom de kentomanie, afin d'éviter la consécration du barbarisme de piquomanie (du grec
 , ,  , je pique), et je tenais à prendre date pour le baptême de ce médico-néologisme.» A. Morel-Lavallée, Un nouveau traitement du morphinisme par la méthode euphorique [...] A propos de la kentomanie, in Annales médico-psychol., II, 322 - M.C. , je pique), et je tenais à prendre date pour le baptême de ce médico-néologisme.» A. Morel-Lavallée, Un nouveau traitement du morphinisme par la méthode euphorique [...] A propos de la kentomanie, in Annales médico-psychol., II, 322 - M.C.
néologisme n.m. PSYCHOPATHOL. - GR[85], TLF, ø d ; in Dabout [1924].
1900 - «[...] les personnages imaginaires font usage des néologismes que le malade a forgés dans son délire : non seulement donc ils ont les mêmes pensées, mais ils les expriment de la même manière que lui : ils sont lui-même dédoublé, multiplié.» M. Ducasse et A. Vigouroux, Du délire systématisé, in R. de psychiatrie, mars, numéro 3, 73 - M.C.
1907 - «[...] les signes catatoniques [...] Néologismes et jargonophasie [...] ne sont nullement pathognomoniques de la démence précoce.» P. Keraval, in L'Encéphale, 25 oct., numéro 10, 405 ; cf. 410 - M.C.
néologisme n.m. PSYCHOPATHOL. - DDL 29, 1900, Ducasse et Vigouroux ; TLF, cit., 1975 ; GR[85], ø d.
1900 - «Le parler extatique [...] est autre chose que la création de néologismes qu'on rencontre dans le rêve, le somnambulisme, l'aliénation mentale [...]» Th. Flournoy, Des Indes à la planète Mars, 191 (Alcan) - P.E.
néologisme mimique loc. nom. m. PSYCHOPATHOL. - ø t. lex. réf. ; absent TLF ; in Moor [1966].
1906 - «TROUBLES PAR ADAPTATION CONVENTIONNELLE. NEOLOGISMES MIMIQUES. - Dans certains cas, l'adaptation du geste à l'idée n'est pas à proprement parler vicieuse, mais elle est conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a de valeur que pour le malade : le lien idéo-moteur est en quelque sorte arbitraire et la signification de l'expression mimique est inaccessible au spectateur non prévenu. Il s'agit là de véritables néologismes, et ces néologismes peuvent être interprétés à condition d'en avoir la clé. [...] Mais les néologismes mimiques sont particulièrement fréquents chez les délirants anciens, en tant que représentations elliptiques ou symboliques. Les malades soulignent alors ou traduisent leurs idées délirantes par des gestes bizarres dont la signification conventionnelle nous échappe, et qui sont dans le domaine de la mimique l'équivalent du néologisme verbal dans le langage parlé et des signes hyéroglyphiques dans le langage écrit.» G. Dromard, Essai de classification des troubles de la mimique chez les aliénés, in Journ. de psychol. , 3e année, 304 et 306 - M.C.
|

 Accueil
Accueil



